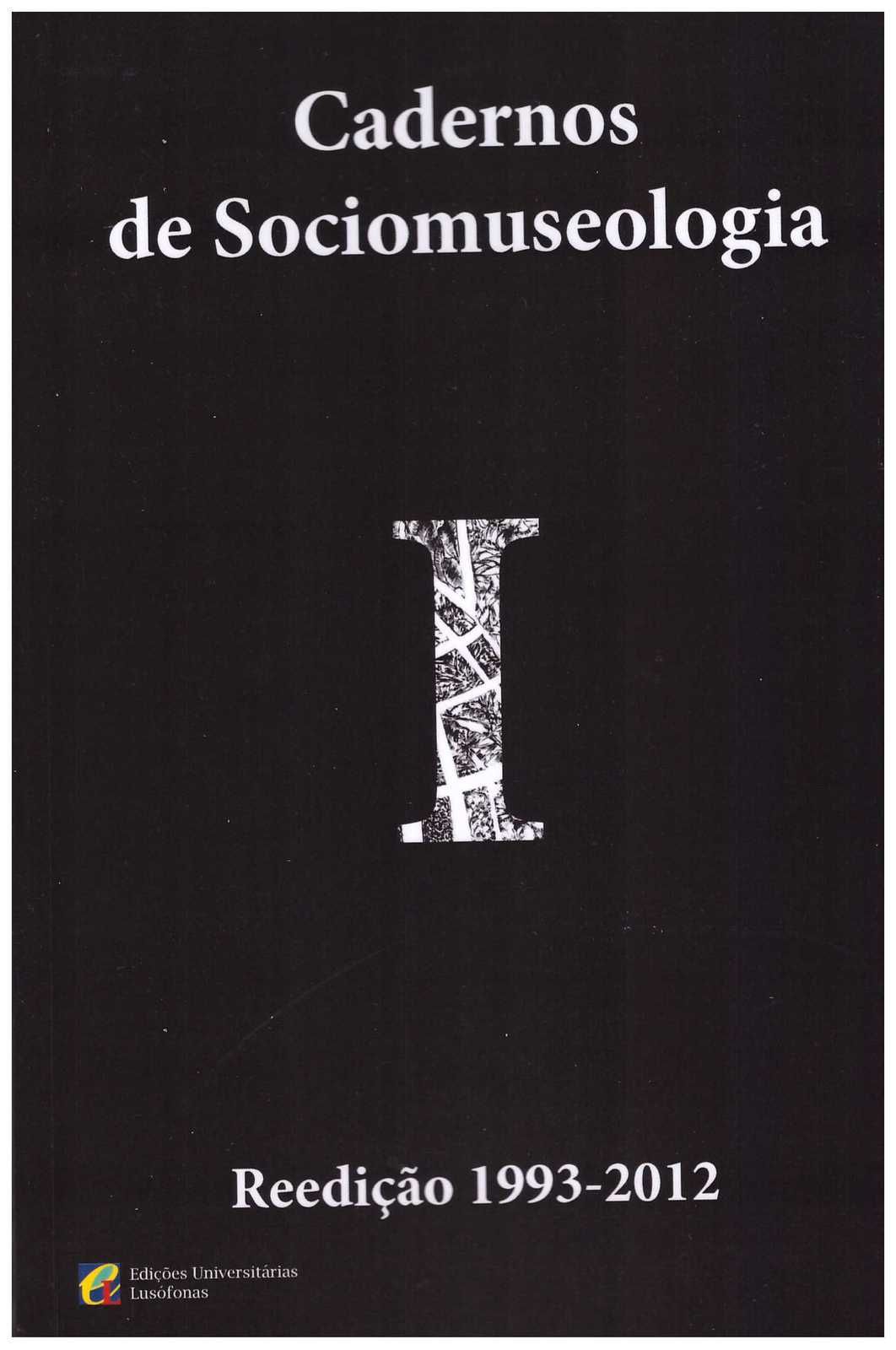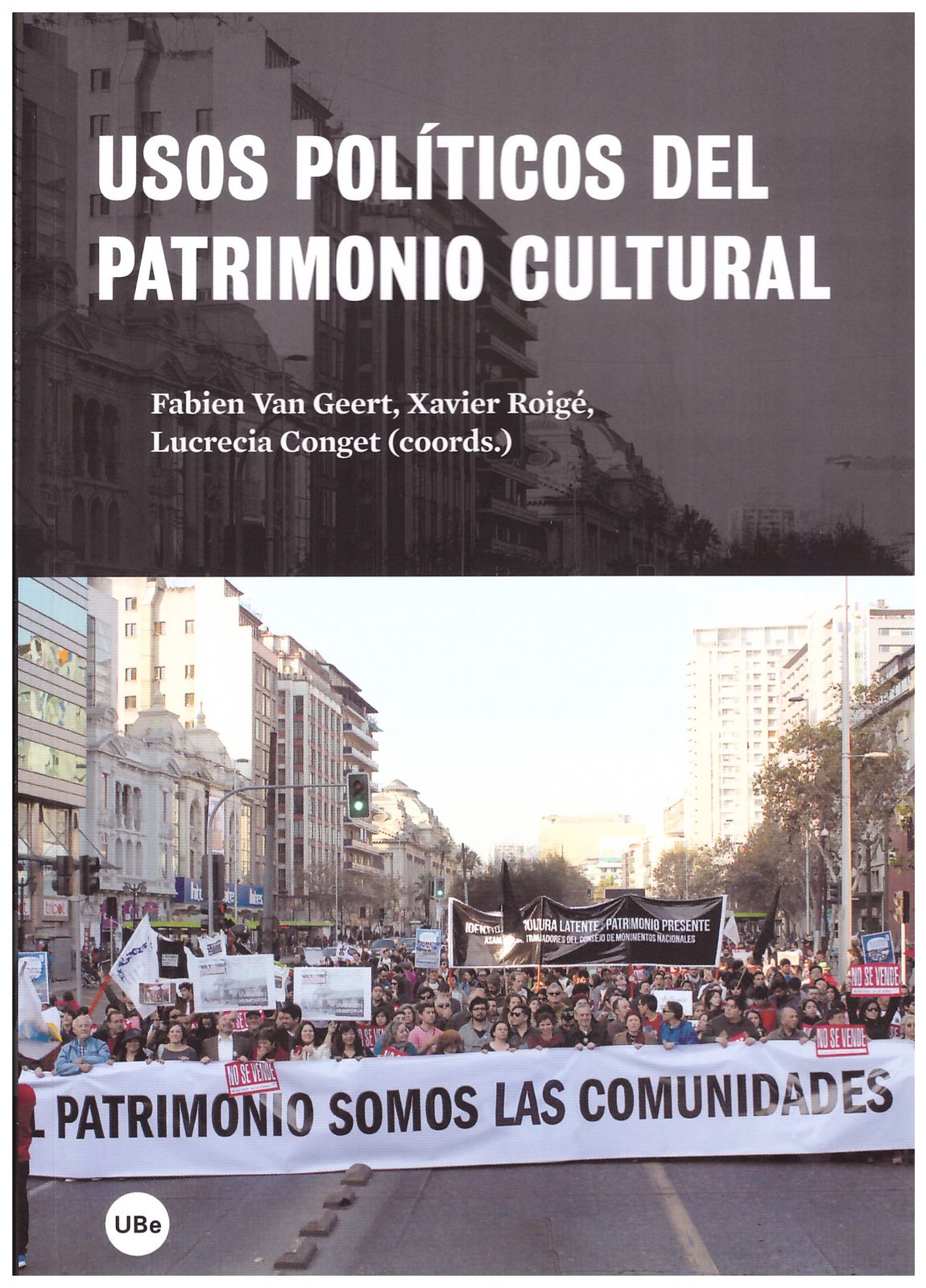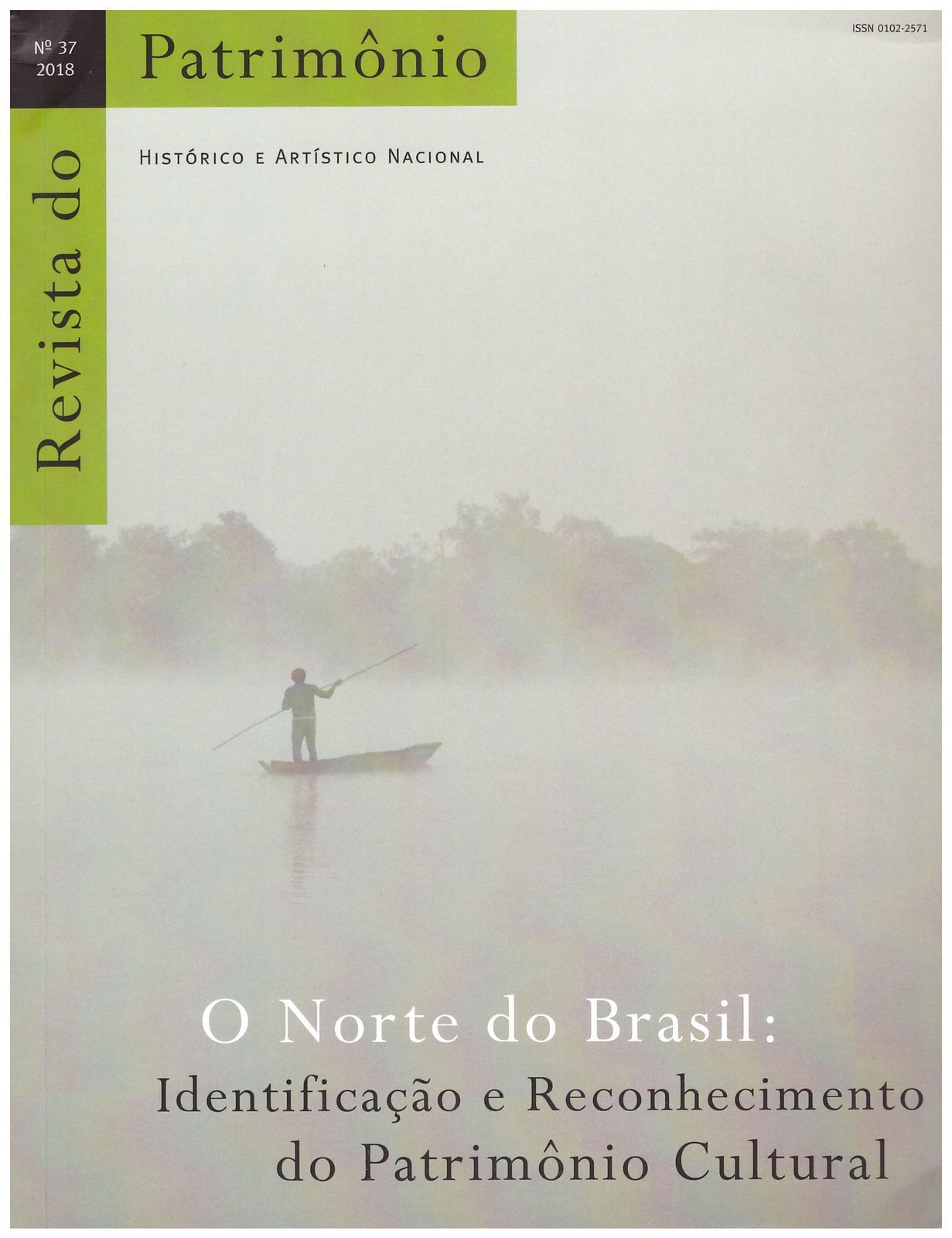Quarante-huit ans après des débats passionnés lors de la 7ème Conférence générale de Grenoble, quarante-cinq ans après l'approbation d'une nouvelle définition du musée par la 8ème Conférence générale de Copenhague, l'ICOM s'apprête à mettre au vote, à Kyoto, le 7 septembre, un projet de définition complètement nouvelle (https://icom.museum/fr/activites/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee). Il se lit ainsi:
Les musées sont des lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d’artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l’égalité des droits et l’égalité d’accès au patrimoine pour tous les peuples.
Les musées n’ont pas de but lucratif. Ils sont participatifs et transparents, et travaillent en collaboration active avec et pour diverses communautés afin de collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer, et améliorer les compréhensions du monde, dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale, à l’égalité mondiale et au bien-être planétaire.
Je ne veux pas intervenir dans un débat qui semble déjà avoir eu lieu en interne et pour lequel je ne me sens pas légitime, n'étant pas moi-même professionnel de musée. Je crois cependant intéressant de faire quelques remarques sur ce projet à l'intention de mes nombreux amis qui s'intéressent à la muséologie et qui sont ou ont été les acteurs et témoins du mouvement que l'on appelait la "nouvelle muséologie".
1. Vu dans son ensemble, ce texte ne ressemble pas à une définition, mais plutôt à une sorte de préambule idéologique qui pourrait convenir à bien d'autres institutions (bibliothèques, archives, départements universitaires, centres culturels, laboratoires). La définition actuelle n'est certes pas parfaite (elle est trop centrée sur la collection), mais elle est acceptée mondialement et sert de référence à bien des documents nationaux et internationaux.
2. Le style compliqué (dialogue critique sur les passés et les futurs) et le vocabulaire ampoulé (lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques) reflètent des préoccupations généreuses qui se réfèrent à des concepts politiques et sociologiques très répandus, qui esquissent une sorte d'idéal tellement exigeant (l’égalité des droits et l’égalité d’accès au patrimoine pour tous les peuples) que l'on aurait du mal à trouver au monde un seul musée qui l'atteindrait.
3. On pourrait plutôt y voir un tableau de quelques critères professionnels et moraux à respecter pour attribuer le label de musée à telle ou telle institution. Mais alors, si nous cherchons à appliquer de telles "normes" (qui n'existent actuellement à ma connaissance dans aucune loi nationale de musées), je crains que l'on rencontre des difficultés:
- quels musées se dédient au dialogue critique sur les passés et les futurs ?
- quels musées sont réellement participatifs et transparents ?
- quel musées peuvent prétendre contribuer efficacement à l’égalité mondiale et au bien-être planétaire ?
4. Certes le musée continue à être organisé autour de collections matérielles et immatérielles dont il est dépositaire et qu'il doit sauvegarder et mettre en valeur, mais peut-il vraiment améliorer les compréhensions du monde ? D'ailleurs, qui, au sein d'un musée, peut dire qu'il comprend le monde, que ce soit au singulier ou au pluriel ?
Cet ensemble de bonnes intentions pourrait trouver sa place dans les discours sur la déontologie des musées et être enseigné aux professionnels de musées, car ce sont eux qui devront faire respecter ces principes dans leurs pratiques, alors que les musées, eux, ont la neutralité de toute institution publique. Pour ne prendre qu'un exemple très actuel: si l'on veut garantir l’égalité d’accès au patrimoine pour tous les peuples, il faudra bien que les responsables des musées prennent les mesures nécessaires pour que les peuples aient accès physiquement et culturellement aux artefacts et spécimens qui appartiennent à leurs patrimoines.